Et les jours passant, je prends mes repères dans cette ville inconnue, dans ce pays lointain, dans cet horaire différent.
J’écris de grand matin. Le ciel est blanc, on attend la neige.La lumière me brûle les yeux, j’ai dû faire pivoter la table de travail pour ne pas m’éblouir. Et le paysage a de quoi : au sud, les grands building, le Saint-Laurent. Face à moi les bâtisses à deux ou trois étages, avec leurs escaliers si emblématiques. De ci de là, de vieilles constructions stylées, de pierre et d’ardoise, contraste avec les toits plats ou les lumineux zincs. Oui, c’est l’Amérique, celle du nord, francophone, francophile même, et humaine. Il y a beaucoup de béton, ici. On en fait même des églises.
“Et si vivre, maintenant, c’était ailleurs ? »
J’ai rêvé New York
A mes heures touristes, je m’imprègne des rues, au cœur et aux frontières de la ville. J’enfile mes gants, mon écharpe et mon bonnet rouges, et je brave les – 5°C, les -15 °C, sourire figé et orteils engoncés dans deux paires de chaussettes. Je traque les brûleries, pour goûter un vrai café… Le système à dosette n’a pas conquis le nouveau continent. Ici c’est café filtre, et je désespère. Heureusement, quelques twittas locales m’ont guidée dans le dédale des chaînes locales pour trouver un peu de jus qui réconforte.
La magie de Twitter, d’ailleurs, m’entraîne aussi dans les bars. Ou plutôt, pour être précise, dans les micro-brasseries locales. Rencontrer des auteurs érotiques ou des blogueurs numériques autour d’une blanche, avec leur blonde ou pas d’ailleurs, prend parfois des allures d’expédition au Pôle Nord. En passant, à tous mes compatriotes qui râlent sur l’état des routes belges, je signale qu’ici, c’est pire. Bien sûr, il y a la neige, les camions, les variations climatiques (parfois 20 °C d’écart d’un jour à l’autre), mais sans rire : les routes sont en très mauvais état. La plupart sont des routes de béton (y’en a partout, vous disais-je), avec des trous où je peux mettre les deux pieds, et des ornières comme des rivières. Pourtant, le budget de fonctionnement municipal de Montréal est de 2050 euros par habitant par an (Namur, budget ordinaire : 1558 euros/an/habitant). Ce qui, l’air de rien, amène à un total de 5, 06 milliards de dollars canadiens (3,38 milliards d’euros) pour une population de 1,65 millions de Montréalais. Sans rire, rien que le budget déneigement, c’est 159 millions de dollars canadien, soit 106 millions d’euros. Je vous rappelle le prix d’un sac de sel ? Ici, le déneigement se fait avec trois camions en enfilade, toutes sirènes hurlantes, et gare à ta voiture si elle est dans le chemin !
Mais faisons fi de ces sujets sérieux, et passons aux joies de la vie. Ici, la chaleur humaine gagne sur le thermomètre, et j’engrange souvenirs, rires et sourires, éclats d’inspiration ou profonds questionnements. Car de ces rencontres se dégage une impression bizarre qui m‘interpelle profondément : les hommes québécois ont peur. Je ne parle pas que de ceux qui participent à mon projet Peaux d’hommes. J’écoute les hommes parler. Et monte une sourde révolte, quelque part entre mon nombril et mes seins. Il me faudra des pages et des pages pour donner les subtilités, étudier, questionner, penser la chose mais il me semble qu’en cette terre canadienne, au continent des libertés, on combat les inégalités des sexes qu’une sorte de guerre froide se joue entre les genres. J’ai bien peur qu’on oublie d’aimer nos différences. Je sais que ne pas prendre les précautions d’usage pour aborder cette question peut être terriblement néfaste au débat. J’y reviendrai donc plus tard, plus longuement.
Car pour l’instant, ce qui me turlu-pine, c’est cette hésitation entre rentrer ou rester. Les attentats de Bruxelles, survenus exactement une semaine après mon passage à Zaventem, m’ont secouée sérieusement. Est-ce vraiment dans ce monde-là que je veux vivre ? Est-ce là ce que j’ai de mieux à offrir à mes enfants ? Bien qu’officiellement en congé, et même partiellement en congé sans solde, je dois assurer le suivi de l’un ou l’autre dossier. Bénévolement, donc, juste par conscience professionnelle… Paradoxalement, je suis un peu inquiète : est-ce que ce début de reconnaissance de mon travail littéraire, qui va de pair avec une petite médiatisation, alors que depuis 15 ans j’écris dans l’ombre, ne va pas me coûter mon job ? Comment mon employeur – j’ai été engagée alors que j’écrivais déjà depuis de nombreuses années, sans m’en cacher, mais sans non plus m’exposer – va -t- il gérer cela ? Et si j’avais le choix de n’être qu’écrivain, ici ou dans un autre pays, prendrais-je le risque ? Puis-je m’offrir ce luxe, avec une meute aux études ? Et peut-on, aujourd’hui, tout plaquer et vivre sur les routes dans son joli combi VW ? Je peux écrire n’importe où. Je l’ai fait à Namur, à Bruxelles, Paris, à Lille, à Liège, à Reykjavík, New York, Sofia, à Montréal, … Est-il temps de bouger ? Qu’est-ce qui nous ancre là où nous vivons, alors que tout est accessible partout ?
Hier, j’ai vu cette offre d’emploi, à Montréal. Il y a quelques jours, j’ai rencontré ces auteurs. Depuis dimanche, j’ai cette pensée qui mûrit en arrière-plan, à partager, à exprimer et à partager, bien plus longuement qu’autour d’une table de café. Et si vivre, maintenant, c’était ailleurs ? Et si la richesse, c’était la découverte ? Si la liberté, c’était le voyage ? Si vivre, c’était y être, bien plus qu’avoirs ?
Vous en pensez quoi, vous ?
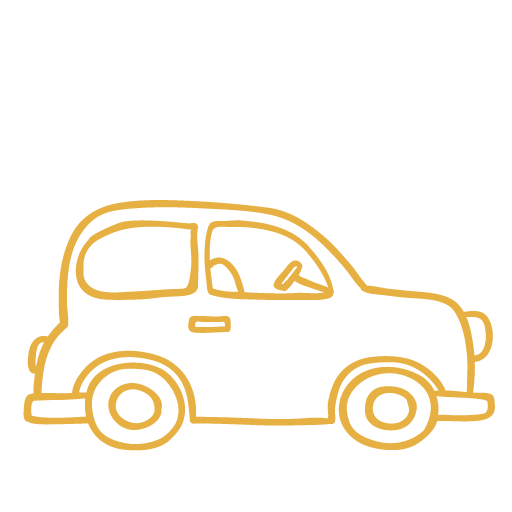
Soyez le premier à commenter